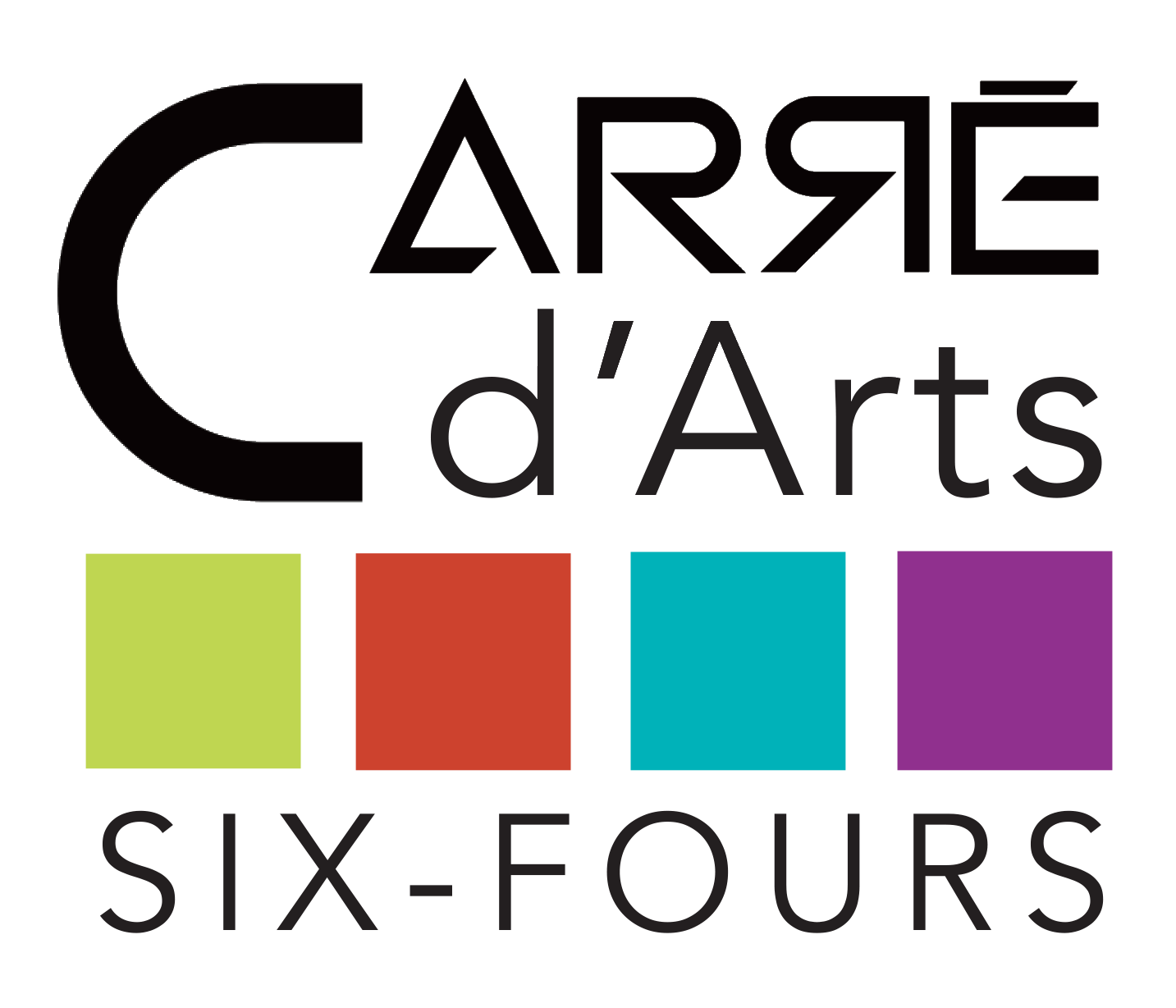En présence d’un paysage urbain de Jérémy Liron, le spectateur éprouve une sensation dérangeante, faite à la fois de familiarité, comme s’il reconnaissait le lieu, et en même temps de défiance, avec le vague sentiment que « quelque chose ne colle pas ». Et ce malaise va s’accentuant au fil des œuvres. Une impression d’autant plus dérangeante que les tableaux, parfaitement exécutés, ne paraissent pas traduire une intention facétieuse chez leur auteur. Pourtant il s’agit le plus souvent de paysages illusoires, imaginés par un esprit doté d’un humour très personnel, avec un goût prononcé pour le private joke, s’amusant à glisser subrepticement dans ses toiles des citations d’œuvres d’autres artistes – comme le pratiquent les musiciens de Jazz dans un chorus – telle une ombre sur un mur qui rappelle les formes déchiquetées de Clifford Still, un buisson taillé en boule comme on en voit chez Edvard Munch, ou une allusion à une œuvre de Per Kirkeby.
" Le spectateur éprouve une sensation dérangeante... "
Une attitude aussi distanciée à l’égard de son propre travail n’est pas exceptionnelle chez les peintres, et traverse toute l’histoire de l’art depuis l’anamorphose d’un crâne dans Les Ambassadeurs d’Hans Holbein, jusqu’à l’œuvre de Picasso, sans oublier évidemment les surréalistes chez lesquels elle en constitue le fondement, et aujourd’hui même chez un peintre aussi tragique que Georg Baselitz. Cet humour discret voire secret, plutôt singulier dans la peinture de paysage, ne saurait masquer l’engagement profond de Jérémy Liron, et le corps à corps qu’il livre quotidiennement face à la toile dans la solitude de son atelier.
S’agissant de sa méthode, il y a d’abord des photographies prises à la volée, par la vitre du train ou en toute autre occasion, de bâtiments et de paysages, sans idée bien arrêtée de ce qu’il en fera. Puis, dans un deuxième temps, par un mélange d’éléments issus de ses prises de vue et/ou de son imagination, une image émergera, pour donner au peintre le sentiment que quelque chose peut en sortir.
C’est ainsi que la peinture de Jérémy Liron se développe : assembler des morceaux de différentes vues, ajouter des parties de son cru, tâtonner, reprendre inlassablement la tâche, jusqu’au moment où soudain « ça tient », comme le pécheur à la ligne qui passe des heures à attendre que « ça morde » et qui souvent revient bredouille.